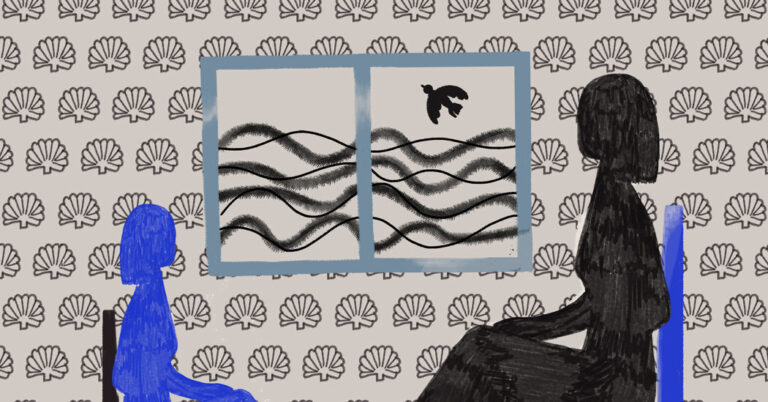Critique de livre : « Zéro à l’os », de Christian Wiman
« On se lasse tellement, dans la vie publique américaine, écrit Christian Wiman avec une soudaine vigueur, des certitudes et des platitudes, des mégaphones et des louanges des stades, des influenceurs et des effluenceurs et de tout le tsunami de déchets qui se déversent dans nos vies comme des substances toxiques. boue. »
Amen à cela!
Oubliez Ozempic pendant une seconde. Face à une telle boue, le nouveau livre de Wiman, « Zero at the Bone », est comme l’un de ces jus de nettoyage fantaisistes d’antan récent, édition intellectuelle : plein de poésie salubre et souvent assez dure, de philosophie et de théologie décomposées en morceaux digestibles. Publié dans 50 « Entrées contre le désespoir » kaléidoscopiques, ce livre est en partie banal, même si certaines des voix citées sont des écrivains moins communs, comme l’insomniaque roumain EM Cioran, qui célèbre « le privilège que certains d’entre nous ont de créer leur propre vie organique ». pulsations ressenties.
Il est brillamment coloré, doux et astringent, tonique, nourrissant et, si vous ne connaissez pas Wiman, peut-être juste une entrée.
Wiman est lui-même un poète qui a publié trois livres précédents, principalement en prose : sur l’ambition et la foi religieuse clarifiée après son diagnostic d’un cancer rare et brutal, et ses rencontres avec certaines des célébrités de son domaine. Amanda Gorman mise à part, c’est probablement une phrase oxymorique, il serait sûrement d’accord, décrivant comment les poètes « se promènent en se reniflant comme des chiens découragés ».
Pourtant, ressentant une « tempête de formes » plus fidèles à la réalité, Wiman a tendance à mélanger ses mémoires avec des éclats de vers, les siens et ceux des autres. Il existe également de longs passages d’analyse littéraire, comparant par exemple Wallace Stevens à William Bronk, que l’on peut imaginer lire à partir de notes prises au pupitre. Rédacteur de longue date du magazine Poetry, Wiman est aujourd’hui professeur à la Yale Divinity School.
Une grande partie de « Zero at the Bone » se déroule loin de Yale : dans les villes chaudes, plates et broussailleuses du Texas où Wiman a grandi, l’enfant doré apparent d’une famille profondément ternie, « mon père disparaissant, ma mère en proie à des souffrances considérables ». la rage et la foi, mes frères et sœurs sombrant dans la drogue et l’alcool, mon propre esprit brûlant la nuit comme un feu d’huile sur l’eau. (Il ne mentionne que brièvement sa propre dépendance aux opiacés et passe peut-être un peu trop de temps à récapituler un bildungsroman abandonné au service de la théorie selon laquelle Dieu est un romancier raté « qui semble en conflit sur la manière – ou l’opportunité – de nous achever ». )
Parallèlement à la fin de l’humanité dans son ensemble, Wiman a été contraint d’affronter sa propre fin en particulier. Son refus de se soumettre à la « camaraderie du cancer » de l’Amérique, essayant plutôt d’expliquer « l’intimité surnaturelle » de sa douleur, m’a rappelé Barbara Ehrenreich. « À travers les chambres/les gardiens blancs vont et viennent/avec leur optimisme et leurs poches de sang », écrit-il avec prudence à propos du traitement hospitalier.
Cette allusion au vif-argent est également présente dans son titre, qui fait référence au dernier vers de « A Narrow Fellow in the Grass », le poème d’Emily Dickinson dans lequel un homme se souvient de ses affrontements avec des serpents pendant son enfance. Wiman est fasciné par ces créatures, non seulement parce qu’elles sont des acteurs clés de la Bible, ni seulement parce qu’elles sont le symbole vertigineux des ouroboros, mais d’une manière personnelle et viscérale. À 6 ou 7 ans, alors qu’il grandissait au Texas, il mangeait du serpent à sonnette avec des cure-dents lors d’une fête foraine. «Ça avait le goût du poulet. Bien sûr que c’était le cas. Vivez assez longtemps et même la mémoire commence à avoir un goût de poulet. Ou un serpent à sonnette. (OK, c’est peut-être l’un de ses passages les plus Forrest Gumpy.)
Il inclut un poème sur l’écrasement d’un serpent noir avec un rouleau compresseur à 16 ans, décrit le meurtre d’autres personnes avec une pelle rétrocaveuse, localise « une excitation semblable à l’excitation sexuelle » à la rencontre d’un spécimen de corail mortel, détaille comment son père a perdu un demi-pied. après la morsure venimeuse d’un autre hochet.
Wiman est devenu extrêmement sensible au monde animal : « les lucioles maculant leur rayonnement extraterrestre » ; un oiseau blanc qu’il n’a jamais identifié mais qui était « la chose la plus proche d’une vision que j’ai jamais eu » ; la balle découverte chez son chien de sauvetage, Mack , et la prise de conscience qu’il existe dans un état de souffrance. Tout le monde porte en soi une balle métaphorique, conclut-il, pas si loin sur le canapé du livre à succès sur les traumatismes de Bruce Perry et Oprah Winfrey « Qu’est-ce qui vous est arrivé ? »
Il considère que « les médicaments qui ont prolongé ma vie ont d’abord brûlé les yeux des rats et des lapins, rongé l’intérieur des poissons zèbres et des petits cobayes au nez frétillant ».
Et il pouvait charmer un athée à partir d’un arbre, partageant dans son intégralité la « Justice de Dieu » de la poétesse canadienne Anne Carson, sur le projet distrayant de la Divinité consistant à créer une libellule « avec des points turquoise sur tout le dos, comme Lauren Bacall ».
« Un jour, Dieu se perd en concevant une libellule », note sèchement Wiman dans son analyse du poème, en le comparant au Livre de Job. « Le lendemain, qui sait, il aurait pu s’impliquer également dans la conception d’une cellule cancéreuse. »
Aux côtés des aperçus sombres de sa famille d’origine, il y a ceux chantants et rédempteurs de sa femme et de ses jeunes filles jumelles. Comme d’autres penseurs professionnels l’ont découvert, les petits fretins ont souvent des idées plus brûlantes que celles de Spinoza.
Pour un chrétien, Wiman peut être lui-même délicieusement venimeux, sifflant à propos d’un restaurant de Chicago aux consonances prétentieuses, de « velours agressif, de serveurs avec des visages de chauves-souris frugivores, d’une sorte de boudin de « privilège » » et du membre du conseil d’administration qui appelle ivre. Lucille Clifton « Louise ». Il admet sa frustration à l’égard de la religion, « pas seulement des manifestations institutionnelles, que même un saint pourrait détester, mais parfois, trop souvent, de tout cela, de l’essentiel, de tout ce foutu truc ».
Je cite trop abondamment — peut-être la pratique est-elle contagieuse — d’un livre profane, irrévérencieux, libre et nécessaire. Les lecteurs, quelle que soit leur croyance, seront poussés à lever la tête de leurs écrans et à les tourner vers les cieux insondables.