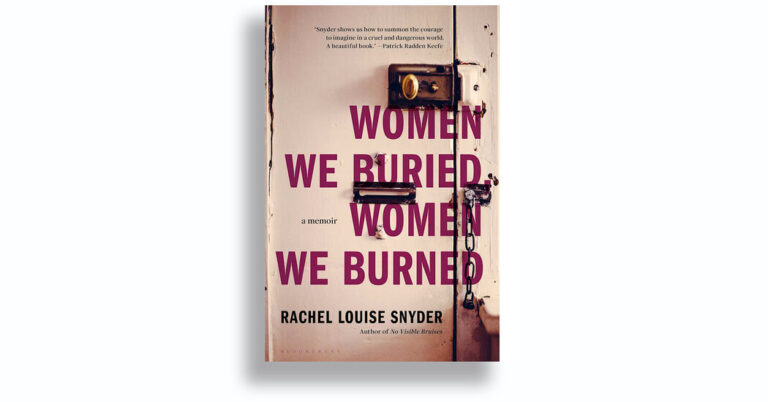Critique de livre : « Pas même les morts », de Juan Gómez Bárcena
Nous ne saurons jamais ce que le regretté Cormac McCarthy aurait pu penser de « Pas même les morts » de Juan Gómez Bárcena, mais je parie que le roman l’aurait séduit, ainsi que Roberto Bolaño et Joseph Conrad, si pour aucune autre raison que leur ego. Chacun d’eux aurait vu des preuves solides de son influence sur Bárcena, dont les travaux précédents – un recueil d’histoires et un roman primé, « The Sky Over Lima » – l’ont déjà établi comme un écrivain de premier plan en Espagne. Son dernier livre, magnifiquement traduit par Katie Whittemore, ne fait qu’ajouter à sa réputation, grâce à son mélange réussi de dynamisme littéraire ambitieux avec un commentaire social et politique contemporain.
« Pas même les morts » commence comme une fable borgésienne : « Voici le récit de la façon dont Juan a poursuivi Juan des environs de Puebla jusqu’à la frontière des États-Unis, un voyage d’une durée de 475 lieues espagnoles et d’un bon nombre d’années. Ce qui suit est une chronique transhistorique alambiquée avec confiance racontée à travers les expériences de deux hommes : Juan de Toñanes, un ex-conquistador monotone tenant une taverne dans le Mexique du XVIe siècle sous domination espagnole, et Juan l’Indien, un autochtone charismatique et formé par des missionnaires. homme causant des problèmes à l’église et à l’État.
Le premier est engagé par la couronne espagnole pour traquer le second. Connu comme le Père de ses partisans, Juan l’Indien est le chef d’un violent mouvement fanatique de gens ordinaires attirés par son énergie féroce et ses propositions hérétiques et déstabilisatrices sur la foi et la politique. Juan de Toñanes, en revanche, est évasif et laconique lors de son recrutement inattendu par des soldats espagnols, mais ce tempérament tiède est attrayant pour un gouvernement colonial à la recherche d’un neutralisant.
Pour une récompense en or et quelque chose de nouveau à faire avec son temps, le tavernier accepte de trouver le Père, de le tuer et de récupérer un livre précieux et dangereux en sa possession. Et ainsi, comme un anti-Quichotte, il se lance dans sa quête sans tambour ni trompette, vers le nord, s’attendant à être chez lui dans quelques semaines. Peu importe que personne ne puisse dire à Juan à quoi ressemble vraiment sa carrière. Pour la suite du roman, cet inconvénient s’avère fécond.
Grâce aux efforts consciencieux de Juan, Bárcena nous montre pourquoi le Père est une source d’appel si dangereux. Un frère qui a enseigné l’Indien dans son enfance raconte fièrement à Juan le zèle du garçon pour la Bible et pour le christianisme, en particulier les parties les plus dures et les plus sombres, et comment il a rapidement condamné son propre père pour ses dévotions aztèques. Les détails biographiques que Juan obtient de tous ceux qu’il rencontre sont toujours équilibrés par des questions non résolues sur ce qu’est devenu le Père, compte tenu des rumeurs d’un tournant tyrannique dans sa vie ultérieure.
« Même à l’intérieur des quatre murs d’un monastère, on entend certaines choses terribles, qu’on veuille ou non les entendre », observe le frère. « Il faut choisir de les croire ou non. Vous avez déjà choisi. En fait, Juan n’est pas entièrement convaincu par le choix qu’il a fait de la nature de l’homme qu’il poursuit, ce qui ne change jamais lorsqu’il rencontre à la fois les puissants et les pauvres, dans les bureaux du gouvernement royal et les villages reculés et défaillants.
Les interlocuteurs de Juan sont unis dans leur sens de la profondeur mystique du Père et de ses effets sur les autres ; aucun d’entre eux n’est en mesure d’en dire beaucoup plus que cela, que Juan enquête seul ou appuyé par une cohorte de soldats coloniaux temporairement réaffectés à lui. Les personnes que Juan rencontre alternent entre ceux physiquement et psychologiquement brutalisés par leurs accrochages avec le Père, et ceux enragés dans leur dévotion envers lui, y compris un personnage délirant à la parole rapide inspiré de l’Arlequin de « Heart of Darkness » de Conrad – un lien qui installe Juan et le Père comme Marlow et Kurtz.
Ailleurs, le Père – comme Juan le découvre en parcourant les pages de la Bible que le Père a narcissiquement réimaginé comme sa propre histoire – apparaît comme une variation sur le monstrueux roi philosophe Judge Holden, du «Blood Meridian» de McCarthy. (Les titres synoptiques qui préfacent chaque chapitre se lisent également comme des hommages à ce roman.) En effet, les riffs bien lus de Bárcena sont parfois un peu trop perceptibles, mais le roman n’est finalement pas miné par ces épisodes de fiction fanboy haut de gamme.
Au fil du temps, il devient clair que Juan ne trouvera jamais le Père – quelque chose qu’il rumine dans des passages de flux de conscience entre ses visites avec des témoins et des guides potentiels. De plus, son voyage de quelques semaines devient inexplicablement, inexorablement un voyage de mois, d’années, de décennies et enfin de siècles. Le Père reste toujours devant lui, avec différentes étiquettes correspondant à différentes incarnations du pouvoir : anti-impérial, anticlérical, pro-révolutionnaire, pro-ouvrier.
Depuis le début, il est célébré par certains comme un défenseur bien-aimé des faibles et des innocents, tandis que d’autres le craignent comme un brutalisateur et, dans une section qui rappelle le « 2666 » de Bolaño, un auteur de violences sexuelles. Inévitablement, les gens commencent à confondre Juan avec le Père, invitant à réfléchir sur l’interaction de l’identité et de l’action, de soi et de l’autre, et sur la relation mutuellement transformatrice entre qui nous sommes et ce que nous recherchons.
Quant à Juan lui-même, il n’abandonne jamais. Bárcena écrit : « Il ne reste plus qu’à avancer. Pour ne pas regarder en arrière. Pour ne pas se poser de questions. Nord, toujours nord. En avant, toujours en avant, sans changer ni remettre en question le cap, car il ne reste plus rien derrière lui ; devant, seul l’avenir peut attendre. Juan chevauche vers cet avenir. À la fin du roman, cet avenir est devenu les États-Unis contemporains, et Juan de Toñanes se révèle brillamment comme une figure de notre moment présent : aux côtés de bien d’autres, il monte à bord de la Bête, le tristement célèbre train qui amène les migrants d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale vers le Frontière américaine.
Après que le protagoniste se soit frayé un chemin dans une nation aussi troublante dans son abondance matérielle que dans son hostilité à son égard, Bárcena se lance dans un camée Trump. Le discours xénophobe qui suit effondre une grande partie de l’ambiguïté bien travaillée et constamment soutenue de ce roman impressionnant – principalement sur ce que signifie rechercher quelque chose que vous ne voudrez peut-être pas trouver – en un absolu hurlant et orange. Mais au moins, cela contribue à ce que Juan se demande enfin s’il pourrait abandonner sa recherche dangereuse, chercher ailleurs et même, peut-être, rentrer chez lui.