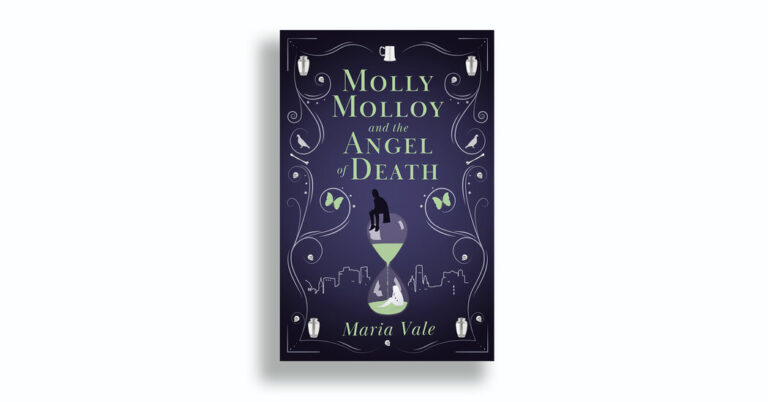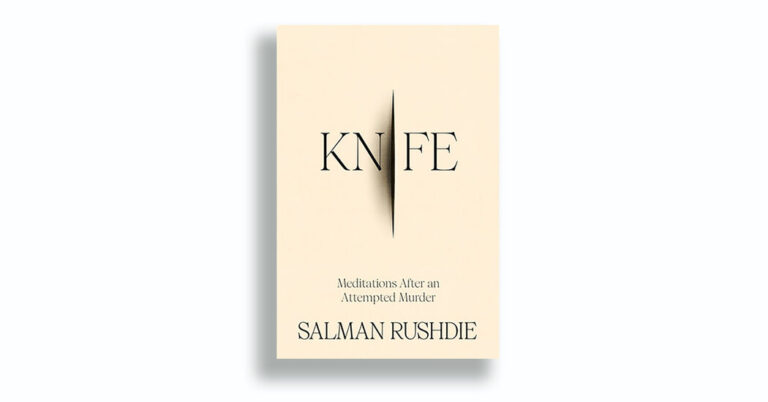Critique de livre : « À qui appartient cette phrase ? » de David Bellos et Alexandre Montagu
L’histoire étonnamment vive de David Bellos et Alexandre Montagu « À qui appartient cette phrase ? arrive avec un timing étrange.
La gueule de bois du réveillon du Nouvel An s’était à peine dissipée que le président de Harvard a été évincé pour des accusations de plagiat et d’attribution inadéquate, suivi de rétorques rapides selon lesquelles l’épouse de son plus grand détracteur, un ancien professeur titulaire au MIT, avait volé des passages de Wikipédia.
Que quelqu’un alerte Smokey Bear : les bosquets universitaires sont en feu.
Comme la théorie de l’« anxiété d’influence » d’Harold Bloom à l’égard des poètes romantiques semble désormais désuète, au milieu de la panique actuelle du copier-coller. À la manière d’un policier corrompu, l’intelligence artificielle recherche d’autres auteurs de plagiat, tout en volant elle-même les mots des écrivains. Même les intelligences naturelles les plus innocentes et les mieux intentionnées d’entre nous pourraient être pardonnées de rester assises debout à 3 heures du matin, s’inquiétant du fait qu’une phrase choisie que nous avions décidé d’imprimer ou des pixels avait déjà été commise par quelqu’un d’autre.
« Engagé » — pardonnez les citations effrayantes, mais… j’ai peur ! Avec l’ascendant de la propriété intellectuelle (PI) préexistante et le piratage déchaîné, l’acte de création peut ressembler à une scène de crime où les preuves ADN sont toutes mélangées. Bellos, traducteur et biographe, et Montagu, avocat, se placent avec confiance derrière le ruban jaune pour nous guider.
Ils font la différence entre le plagiat, une question d’honneur débattue depuis l’Antiquité (et un thème, de manière révélatrice, dans de nombreux romans récents) ; le droit d’auteur, une préoccupation du droit moderne et, surtout, du lucre (« la plus grande machine à sous que le monde ait jamais connue ») ; et marque déposée. Si je voulais qu’une photo de Smokey Bear soit publiée avec cet article, par exemple – et je le fais vraiment – le New York Times devrait débourser.
Les chapitres des auteurs sont courts mais leur portée, comme le bras du droit lui-même, est longue. Nous voyageons depuis l’indignation de Platon contre Hermodore, qui fit copier et publier les notes de son professeur ; à l’impression sur bois en Chine ; la Stationers’ Company, l’un des premiers organismes de réglementation de Londres ; et la Convention de Berne de 1886 en Suisse, qui a à la fois codifié et compliqué le droit d’auteur international tel que nous le connaissons.
Et bien sûr sur le réseau sans nation, où les tentacules de la fanfiction moderne se propagent de manière exponentielle, voire légalement, et où les médias sociaux posent d’énormes problèmes imprévus à la société civile. « Comment trier les bons livres des mauvais messages sans erreur est un problème qu’aucune loi n’a vraiment résolu », écrivent les auteurs, rappelant que Facebook profite de nos publications sans en être responsable. « C’est une blague, mais cela ne devrait pas nous faire rire. »
Eux-mêmes ont une attitude ironique envers le matériel technique ; c’est moins un droit d’auteur pour les nuls, comme cette série sans cesse étendue, imitée et usurpée, que pour les beaux esprits. Découragés par leur éditeur de nommer un titre de chapitre d’après « All You Need Is Love » des Beatles, les auteurs illustrent adroitement cette circonstance « absurde » en décrivant uniquement avec des détails identifiables le groupe et la chanson.
Bien que souvent comparé au vol, incorporer des morceaux d’œuvres écrites protégées dans les vôtres – comme le doivent les critiques – ne vous mènera pas en prison, rassurent Bello et Montagu. Le droit d’auteur est une entité bien plus controversée et nébuleuse que le meurtre – et, selon les auteurs, les lois qui le régissent sont prêtes à être révisées.
Alors que Bellos est professeur de littérature comparée à Princeton, « à qui appartient cette phrase ? » n’aurait pas pu anticiper l’actuelle Poison Ivy League. Mais il évoque la première version de Mickey Mouse dans « Steamboat Willie », rendue publique il y a quelques jours par le Copyright Term Extension Act de 1998, alias le Sonny Bono Act, qui protégeait ce Mickey au nez pointu que tant de gens ont peut-être oublié. lui. Ce n’est pas le cas du Gatsby de F. Scott Fitzgerald, dont la propre libération a engendré une version vampire et d’autres horreurs. (La loi Alexandra Jacobs interdira aux gens de lire « The Hours » de Michael Cunningham jusqu’à ce qu’ils aient terminé « Mrs. Dalloway ».)
Bellos et Montagu défendent le petit bonhomme, l’écrivain – qui semble devenir de plus en plus petit – contre les énormes Goliaths du divertissement. Un fait sombre : seul un millier de personnes au Royaume-Uni gagnent leur vie en écrivant des livres.
Il y a des histoires soigneusement annotées comme celle du documentariste qui colle un de ses propres films sur un écran de télévision en arrière-plan de « Sing Faster », sur les machinistes qui ont travaillé sur le cycle « Ring » de Wagner, pour ne pas avoir à le faire. payer 10 000 $ à un studio pour montrer le segment de quatre secondes des « Simpsons » qu’ils regardaient réellement.
En quoi était-ce bon pour quelqu’un ? Pas le public du documentaire, qui a raté l’occasion de voir à quel point les machinistes se sont vraiment détendus ; pas son créateur, qui a dû améliorer la réalité juste pour garder ses lumières allumées ; pas le studio, dont le prix absurde n’a pas été atteint.
En lisant cette anecdote, je me suis interrogé sur une séquence préférée de « Maestro », le biopic du chef d’orchestre et compositeur Leonard Bernstein qui a bénéficié de la coopération de sa succession. Interprété par Bradley Cooper avec un nez prothétique qui mérite peut-être son propre brevet à ce stade, Bernstein rentre à la maison le jour de Thanksgiving pour trouver un animal en peluche Snoopy abandonné dans le vestibule de son somptueux appartement. « C’est son jour! » il proteste. Et quelques minutes plus tard, alors que Bernstein et sa femme (Carey Mulligan) se chamaillent dans leur chambre au Dakota, un char géant Snoopy du défilé Macy’s apparaît de manière comique par la fenêtre.
Combien, le cas échéant, je me demande maintenant, a coûté l’obtention des droits sur ce personnage auprès de Peanuts Worldwide ? Est-ce que quelqu’un sans Amblin Entertainment de Steven Spielberg derrière lui aurait pu l’inclure ?
Le large éventail d’exemples dans « À qui appartient cette phrase ? » je me suis également demandé ce qui restait de côté. Les lecteurs découvriront comment JM Barrie a fait don de « Peter Pan » à un hôpital pour enfants, les inquiétudes de Milan Kundera concernant la traduction et comment la femme d’Alexandre Pouchkine l’a tué deux fois (en le mettant en duel et en restreignant son lectorat avec la protection du droit d’auteur). Rien, cependant, sur le sampling dans le hip-hop, ou sur Weird Al Yankovic.
Mais en encourageant la contemplation au-delà d’éléments spécifiques de ce que l’on appelle aujourd’hui sombrement le « contenu », le livre réussit. Espérons que les extraits sortent tout juste de la machine Xerox™ et soient rassemblés pour les salles de classe des universités à travers le pays.